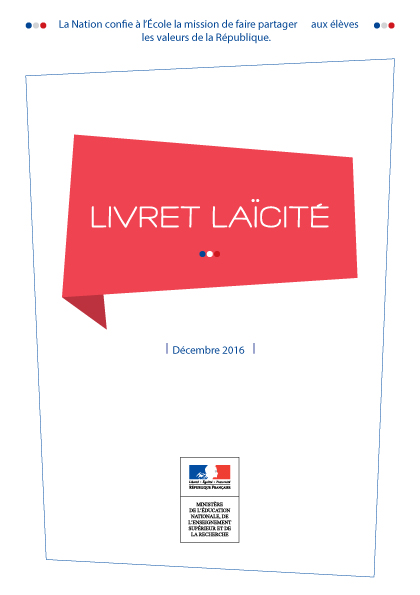Ajouter cet article à vos favoris
Ajouter cet article à vos favoris 
Dans ce texte intitulé “les manuels scolaires et le fait religieux” , Charles-Edouard Harang, agrégé d’histoire, docteur en histoire, professeur au lycée R. Queneau, fait une analyse approfondie de manuels d’histoire. Il présente ici en six séquences
- les données du problème (pourquoi enseigner le fait religieux à l’école ? Qu’est-ce que le fait religieux ? La place dans l’enseignement)
- les manuels
- le fait religieux dans le monde contemporain
- les religions du Livre ? Bible, Coran, documents patrimoniaux et manuels scolaires
- la naissance du christianisme dans les manuels de 6e et de 2nde
- l’islam, des manuels de 5e à ceux de terminale, en passant par la première professionnelle
Les manuels scolaires et le fait religieux
La France est une République laïque. Depuis la Troisième République, la laïcisation de l’enseignement a été l’une des premières manifestations de la volonté politique de laïciser la société civile. L’enseignement religieux, considéré comme relevant du domaine privé est alors confié aux prêtres et aux familles. Cependant les républicains considéraient que l’histoire des religions avait toute sa place dans l’enseignement surtout universitaire.
Mais le contexte français a été bouleversé à partir des années 1970 :
- Déprise de l’Eglise catholique et du catholicisme : sécularisation des comportements.
- Installation d’une population issue de l’immigration africaine et de confession musulmane.
- Evolution profonde dans l’éducation nationale sous le coup du renouvellement des pratiques pédagogiques et de l’ouverture du secondaire à un public plus large.
Aussi, dès les années 1980, la presse écrite se fait l’écho des inquiétudes de la société française face au manque de culture des élèves et spécialement en matière de culture religieuse. L’intérêt et la rénovation des programmes en faveur du fait religieux est avant tout une réponse à une demande sociale face aux échecs de l’intégration et aux manifestations d’une inculture générale.
Pour le grand public, l’éducation nationale en porterait la responsabilité alors même que c’est à une crise générale de la transmission que doit faire face la société française :
- Crise de la transmission au sein des familles,
- Défaillance des grandes institutions structurantes de l’espace social (syndicats, partis politiques, Eglises).
Ainsi, en 1988 le ministère de l’éducation nationale confie à l’historien Philippe Joutard une mission de réflexion sur le sujet. Le rapport Joutard conclut à la nécessité de remédier à l’inculture constatée en accordant une plus grande place à l’histoire des religions en histoire, en géographie et en littérature. Les enseignants doivent selon le rapport montrer « l’importance du fait religieux dans l’histoire et sa permanence dans le monde contemporain ». Le rapport souligne également « l’insertion du religieux dans la vie culturelle et la civilisation du quotidien ».
La réforme des programmes de 1996 prend en compte les recommandations du rapport Joutard au collège et au lycée. Mais les évènements du 11 septembre 2001, puis les attentats de Madrid (11 mars 2004), les affaires sur le voile, l’affaire des caricatures de Mahomet ont un impact immédiat sur l’enseignement. Les élèves assaillent leurs professeurs de questions sur les religions et leurs intégrismes. Le ministère confie alors au philosophe Régis Debray une mission sur l’enseignement du fait religieux. (…)
Pourquoi enseigner le fait religieux à l'école?
Brigitte Morand IUFM de Montpellier
Livret Laïcité
Livret destiné aux chefs d’établissement, aux directeurs d’école, mais aussi aux équipes éducatives de l’enseignement public français.
Édito de Najat Vallaud-Belkacem Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
La refondation de l’École porte cette ambition : lui redonner les moyens de remplir sa mission d’apprentissage des savoirs, mais aussi de transmission des valeurs laïques et républicaines. L’École de la réussite pour tous les élèves doit aussi être celle de l’émancipation, de la formation de l’esprit critique, de la compréhension du monde et des règles qui fondent notre appartenance commune à la République.
Avec les lois de 1882 et 1886 instituant la laïcité des enseignements et la neutralité des personnels, l’école publique a porté la laïcité avant même la loi de 1905, comme principe qui permet la cohabitation de ceux qui ont des convictions religieuses différentes et également de ceux qui n’en n’ont pas. C’est ce principe exigeant qui, en transformant les enfants en élèves, en distinguant le savoir du croire, crée un cadre propice aux apprentissages, établit les règles de la vie scolaire et fonde l’autorité des maîtres. La pédagogie de la laïcité est ainsi un élément central de la refondation de l’École. Elle s’appuie sur le nouvel enseignement moral et civique, mais aussi sur la Charte de la laïcité à l’École portée par toute la communauté éducative. Elle est transmise dans l’ensemble de la vie scolaire grâce à l’implication de tous les personnels de l’École, dont l’éthique professionnelle implique la neutralité en matière de convictions personnelles, et l’engagement dans la transmission des valeurs de la République. L’École de la République ne laisse aucun comportement contraire à ses valeurs prospérer en son sein. La pédagogie de la laïcité s’accompagne donc d’une recherche permanente de dialogue, dont la bienveillance n’exclut pas la fermeté, avec les élèves comme avec leurs parents, chaque fois que cela est nécessaire.
Ce livret est destiné aux chefs d’établissement, directeurs d’école mais aussi aux équipes éducatives de l’enseignement public. Réédité dans une formule augmentée et actualisée pour répondre aux questions les plus concrètes, il indique des pistes pour faire comprendre et vivre la laïcité dans les établissements scolaires, fournit des repères pour le dialogue éducatif et des éléments juridiques en cas de contestation ou d’atteinte au principe de laïcité. Son contenu est complémentaire de l’accompagnement que les référents académiques laïcité peuvent apporter, afin qu’aucun professionnel, aucune équipe éducative, ne se sente isolé ou démuni vis-à-vis du respect du principe de laïcité à l’École.
C’est à cette condition d’une communauté éducative formée, accompagnée, outillée et soutenue, que la laïcité sera pleinement appropriée par les élèves, accompagnant leur épanouissement en tant que futurs citoyens. Je vous remercie de votre engagement au service de cette ambition républicaine.
La laïcité relève en effet du droit politique, même si elle ne s’y réduit pas. On attend du droit qu’il organise et protège les libertés afin que les rapports humains ne soient pas complètement livrés à la loi du plus fort
La laïcité s’est formée historiquement, au travers de luttes émancipatrices pour la liberté, pour la paix, pour l’égalité… Elle se réfère à la libre pensée et traite de la religion, sans être elle-même ni une religion ni un athéisme, et sans être antireligieuse ni hostile à l’athéisme. Elle prend des formes diverses dans l’histoire et comporte des sensibilités différentes, plus ou moins disposées à s’accorder, selon les périodes et suivant les sujets
Livret - 2017